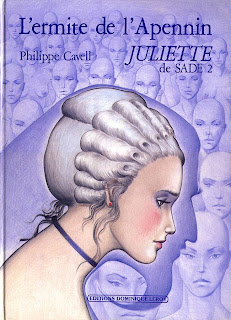Un auteur victime de dictature (il a connu les
geôles de Pinochet puis l’exil), accompagné d’un photographe
qui sera, lui, victime de crétinerie (ces crétins qui ont jeté à
la poubelle, en octobre 2012, toutes ses archives photographiques
entreposées dans des locaux du journal Le Monde,
soit près de 50.000 images
représentant 27 ans de travail), voilà le duo dans les pas
duquel j’ai mis mes pas, direction le Sud.
Le
parcours de Luis Sepúlveda
ne s’englue
pas dans la monotonie : militant communiste, peine de prison
commuée en exil supposé vers la Suède mais transformé par lui en
voyage clandestin dans toute l’Amérique du Sud, combattant dans
une brigade internationale sandiniste au Nicaragua, fondateur d’une
troupe de théâtre, militant des droits de l’homme, défenseur des
peuples premiers, reporter, auteur, figure
chilienne des lettres installée dans les Asturies espagnoles.
Daniel Mordzinski,
photographe natif de Buenos Aires et
lié de cœur à Paris,
portraitiste
d’écrivains, travaille, selon ses propres mots, « depuis
plus de trente ans à un ambitieux
« atlas humain » de la littérature ibéro-américaine ».
Ce duo
avait déjà collaboré, l’un aux textes, l’autre aux images, à
l’occasion de divers reportages. Mais je méconnaissais l’œuvre
de l’auteur, et étais peu familier de celle du photographe. Le
lancement récent (avril
2013) de la
collection « Aventure »,
aux éditions Points, sous la direction littéraire de Patrice
Franceschi,
a fait le larron : nous
voilà donc partis tous trois vers le Sud : eux deux, et moi en
passager semi-clandestin, lecteur de Dernières
nouvelles du Sud
(EAN : 9782757833735),
une des
premières publications de cette nouvelle collection.
Ligne
symbolique
de départ
géographique
du périple,
le parallèle de 42° de latitude sud. Pour
un départ terrestre, il ne faut pas trop se tromper ; si vous
prenez un globe ou un planisphère et que vous suivez du regard ou du
doigt cette parallèle, vous ne croiserez pas beaucoup de terre :
pointe sud de l’Australie, mi-hauteur de la Nouvelle-Zélande, et
un bout de Chili et d’Argentine. A peu de choses près, c’est
tout.
Ligne de
départ temporelle : 1996. Une
poignée d’années plus tôt, le ministre argentin de l’économie,
Domingo Cavallo a introduit le système de convertibilité du peso, à
un taux de change garanti d’un peso pour un dollar. L’inflation
est sensiblement freinée (elle
dépassait 5000 % en 1989 !).
Dans les
années qui suivent, le gouvernement se lance dans un programme
ambitieux de néolibéralisme
et dérégulation, allégeant les barrières douanières et
privatisant à tout crin dans les secteurs du pétrole, de l’énergie,
des télécommunications, des transports, etc. Les
marchés financiers argentins sont affectés par la crise du peso
mexicain de 1995, l’économie chancelle, l’Argentine emprunte
massivement. Le
pays se désindustrialise, le chômage, la précarité
de l’emploi et la pauvreté augmente. Les
coups de boutoir des crises financières asiatique (1997) et
brésilienne (1998) ne
l’ont pas
encore mise
KO, mais
l’Argentine de
1996 est déjà un grand malade.
Le
voyage a failli ne pas partir. Le premier chapitre du livre est
consternant : il se révèle quasiment impossible de trouver, à
Buenos Aires, comment prendre le train pour se rendre en Patagonie.
Dans un cauchemar kafakïen, Sepúlveda
est renvoyé
de bureau minable en immeuble presque désaffecté, par des gens qui
sont, pour certains, déboussolés et, pour d’autres, totalement
détachés, chacun réagissant à sa manière au torpillage des
chemins de fer publics.
Le
voyage de Sepúlveda et Mordzinski est une rencontre avec la
Patagonie de 1996, Patagonie
dont le 42° Sud est à peu près la limite septentrionale et le cap
Horn la pointe Sud.
Une
rencontre physique, avec un territoire vaste
(2 fois la superficie de la France), souvent rude (le climat y est
océanique froid en majorité, et semi-aride ou aride dans certains
secteurs). Un
pays à parcourir en train (et ce n’est pas une mince affaire,
depuis que leur privatisation a mis les chemins de fer argentins à
genoux) ou
en voiture tout-terrain, à
survoler dans
un avion
d’un
autre temps, à fouler à pied pour mieux le ressentir.
Une
rencontre humaine, surtout. Une
rencontre faite de rencontres, avec des gens qui deviennent les
personnages d’une
pièce de théâtre dont on se demande jusqu’à quand vont tenir
les décors et ce
qui se passera si le rideau tombe.
Alors,
ces Dernières nouvelles du Sud, plutôt « mosaïque de
rencontres » que « récit de voyage » ? Oui,
indubitablement, si
l’on s’en tient aux seuls mots de Sepúlveda.
Mais les
photos de Mordzinski
(prises
avec un Leica M6, un Canon F1, et un Polaroid pour les essais –
un ensemble que ce photographe appelle son « armement
conventionnel »)
apportent
ce regard supplémentaire, tant sur les lieux que sur les gens.
Certaines
images – les portraits en particulier – sont des échos directs
aux mots de l’auteur, mais
d’autres sont
un apport plus « personnel » du photographe. Le
noir et blanc, dont on sait qu’il se prête bien au portrait
intense, surtout pour des visages marqués par la vie, traduit bien,
aussi, la force des paysages patagoniens. Un petit regret : le
format de poche ne
rend pas assez bien hommage à ces images, qui s’y retrouvent à
l’étroit.

Ces
portraits, en mots et en images, ces anecdotes, sont touchants et
ambivalents. Ils nous parlent de gens d’aujourd’hui, de temps
passés (pas
toujours meilleurs), et de temps à venir (dont
ils se demandent à quel point ils seront pires). Ce
qui frappe, c’est la simplicité de ces gens rencontrés, qu’ils
soient en Patagonie par choix d’y rester ou par impossibilité
d’aller ailleurs. Ce
qui frappe, c’est que pour certains, il semble que le monde
« extérieur » ne changera rien à leur vie, alors que
pour d’autres, l’intrusion
de flots d’argent est
une lame de fond qui peut emporter leur univers un peu intemporel.
Mais chacun
a ses satisfactions : une vieille dame dont les mains ont le
pouvoir de guérir les gens et de faire pousser les fleurs sur les
tiges que l’on croyait mortes ; des
cheminots qui se rebellent contre un groupe d’États-uniens pleins
de morgue qui ont « chartérisé » le dernier train de
Patagonie
pour leur usage exclusif et lancent leur locomotive à
vapeur sur
les rails d’une
temporaire – mais grisante – liberté ;
un luthier
qui cherche, au milieu de nulle part (du moins le lecteur le
croit-il), du bois pour fabriquer un violon.

Bercées
de mélancolie comme sur un air de tango, parfois
teintées de nostalgie d’un temps qui ne reviendra pas, assurément
marquées d’inquiétude, quelques
fois tragi-comiques ou
portées par la colère, ces
Dernières
nouvelles du Sud,
douces-amères,
sans
prétendre donner des « leçons de vie », m’ont tout de
même amené
à réfléchir sur un certain sens de la vie, la mienne et – au
risque de passer pour présomptueux ou béatement idéaliste – sur
celle du monde.
* * * * *
En complément :
* * * * *
Défi. Ce billet répond au défi suivant :